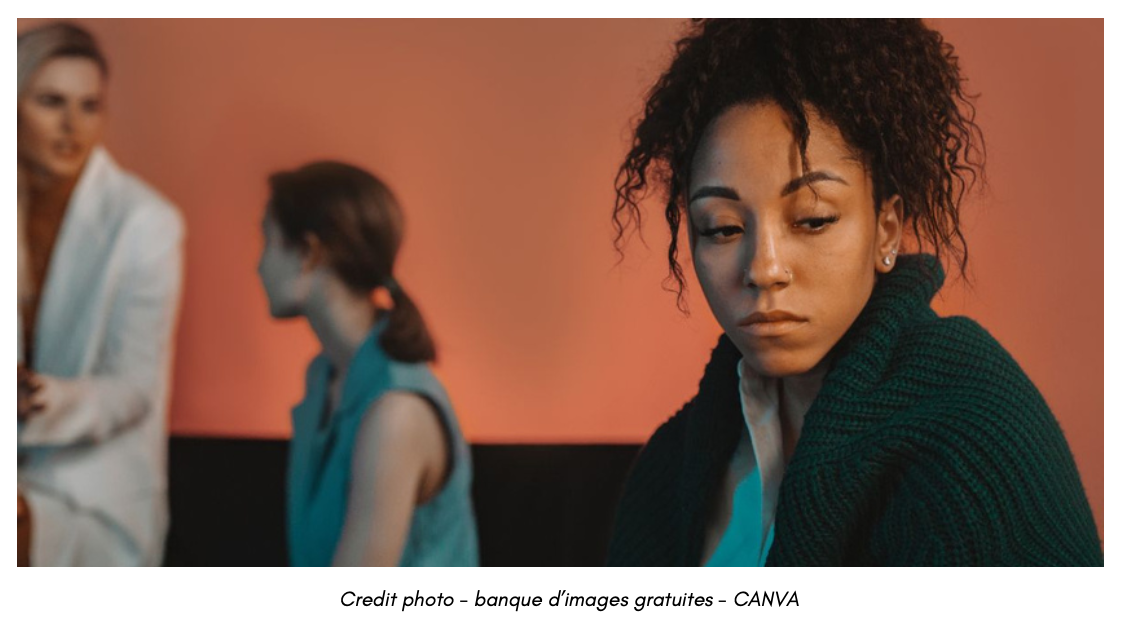PAR ANTOINE TURPAULT
Entre les nombreux procès médiatiques et l’invariable nécessité de laisser la Justice faire son travail, l’intégrité peine à trouver sa place dans une atmosphère de plus en plus conflictuelle. Le débat autour d’une justice spécialisée en matière de violences faites aux femmes prend de plus en plus d’ampleur.
Tandis que Roman Polanski tente de décrocher une place à Cannes et à la Mostra avec son nouveau film The Palace et que Benjamin Mendy a été jugé non coupable par un jury populaire après six accusations de viol, un sentiment d’injustice plane encore autour des affaires de violences faites aux femmes au point de se demander si la Justice est réellement impartiale.
Une justice spécialisée pour les violences faites aux femmes reviendrait-elle à croire aveuglément toute personne affirmant être victime d’une agression ?
« La justice, c’est nous tou(te)s qui la rendons »
Ilhame AGUIDA, directrice du CIDFF 95
Sûrement pas, mais elle participerait peut-être à remettre en question notre représentation du monde qui, elle, influence notre propension à croire ou ne pas croire tel ou tel récit. En effet, notre capacité à croire ou non la parole d’autrui dépend de nos connaissances, expériences et valeurs inculquées. Or, dans une société patriarcale qui surprotège encore les hommes violents de façon insidieuse, la nécessité de changer les règles du jeu semble de plus en plus urgente pour qu’il devienne enfin plus équitable. L’affaire Benjamin Mendy, comme toutes les autres avant elle, illustre le caractère encore beaucoup trop « exceptionnel » que nous leur conférons. Il ne s’agirait que d’un fait-divers de plus, réglé selon l’adage “parole contre parole”.
Or, la parole des hommes pèse beaucoup plus dans notre société que celle des femmes. La socialisation genrée dont résultent les violences faites aux femmes détermine encore foncièrement la façon dont on considère et juge ces affaires. Comment court-circuiter ce cercle vicieux ? Comment rééquilibrer ce rapport de force ? Faut-il aller jusqu’à transformer les « présumés innocents » en « présumés coupables » quand nous savons que 80% des condamnés pour violences faites aux femmes ont nié les faits reprochés lors de leurs procès ?
La Justice face à des violences systémiques et reproductibles
Aujourd’hui, la véracité de la plupart des dénonciations d’agressions sexuelles peut très difficilement être remise en cause. On estime que les accusations infondées de violences sexistes et sexuelles représentent 2 à 8%* des plaintes (sachant que seulement 12%** des victimes de violences sexistes et sexuelles portent plainte, découragées par le système). Le fait est qu’il n’y a aucun bénéfice à en tirer, et beaucoup d’inconvénients : jugement, représailles, harcèlement, violences institutionnelles, etc. Pourtant, le sexisme ambiant dans notre société nous conditionne collectivement à n’accorder encore que très peu de crédit à la parole des femmes : “Les femmes sont vicieuses par nature” ; “Les femmes mentent pour piéger les hommes” ; “Les femmes sont cupides” ; “Il n’y a pas de fumée sans feu”. Quand ce n’est pas ces discours sexistes qui l’emportent, c’est un silence assourdissant qui s’abat à la place sous l’égide de la “présomption d’innocence” ; les preuves, rien que les preuves. Or, le silence profite aux agresseurs. Les potentiels “je te crois” adressés aux victimes n’auraient pourtant jamais de conséquences sur la liberté d’un accusé. De fait, si Benjamin Mendy a été suspendu par son club avant d’avoir été jugé, de la même façon que l’acteur Sofiane Bennacer a été exclu de la présélection des Césars, leur statut de « présumé innocent” leur a offert le moyen de recourir à la victimisation et a laissé place à de nombreuses polémiques, participant à décrédibiliser une fois de plus la parole des victimes face à une opinion publique muette. La justice apparaît alors comme la seule arbitre d’un jeu dont les règles la dépassent car les violences faites aux femmes ne sont pas des événements ponctuels et originaux, mais des violences systémiques qui obéissent à des déterminants sociaux. C’est pourquoi Roman Polanski peut encore aujourd’hui tenter de décrocher une place à Cannes et à la Mostra avec son nouveau film The Palace. “Laissons la justice travailler” aime nous répéter le Ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. A-t-elle seulement les moyens de faire son travail ? Lorsqu’ils ne peuvent pas avoir lieu honnêtement dans un tribunal, les procès s’invitent alors dans les médias pour tenter de faire évoluer nos représentations.
Sans aller jusqu’à remettre en question « la présomption d’innocence » car il faut heureusement des preuves pour condamner quelqu’un en France, la problématique des violences faites aux femmes invite finalement la justice à se réinventer. En 2020, en France, on comptabilise en moyenne 67 viols*** par jour (sachant qu’il ne s’agit que des constatations faites par la police et la gendarmerie) et un féminicide advient tous les trois jours (sachant que les personnes trans et les travailleuses du sexe sont souvent exclues des comptes). Une personne sur 10**** est également victime d’inceste. La lumière faite sur toutes ces victimes nous oblige à une prise de conscience collective. Si ce sont d’abord les victimes de leur(s) agresseur(s), ce sont également les victimes d’une société qui les protège et les reproduit. Comment enrayer cette machine ? Ces faits particuliers dépassent en fait le seul cadre judiciaire et demandent une prise en charge coordonnée, à la fois globale et spécifique, qui serait nécessairement accompagnée d’une remise en question généralisée.
Le système espagnol en avance sur le système français
En Europe, l’Espagne fait office de précurseur en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon le rapport du Centre Hubertine Auclert, “la prise en charge coordonnée des victimes, la création de juridictions spécialisées et la publication mensuelle d’indicateurs ont permis la baisse du nombre de féminicides et une meilleure protection des femmes victimes de violences depuis 2004. Ainsi, le taux de féminicides en Espagne est deux fois moindre que celui en France (146 féminicides au sein du couple en France en 2019, contre 55 en Espagne)”.
Le modèle espagnol repose sur des équipes dédiées à ces faits particuliers dans les commissariats. Depuis juin 2019, Valence abrite d’ailleurs le premier commissariat du pays uniquement dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Or, s’il existe des brigades locales de protection de la famille en France, celles-ci n’existent pas dans tous les commissariats.
L’Espagne a également mis en place une plateforme d’évaluation du danger du nom de Viogen qui permet notamment de déterminer les jours les plus “à risque” dans l’année pour les femmes. Ce dispositif semble efficace car la part de victimes tuées par leur conjoint et qui avaient porté plainte est passé de 75 % à 20 % entre 2009 et 2019. 56 000 femmes sont actuellement protégées en Espagne et le taux de condamnation des hommes violents y est deux fois plus élevé qu’en France.
Ayant droit à une assistance juridique gratuite, à un accompagnement psychologique et à des aides économiques spécifiques, les femmes victimes bénéficient également de plus de droits sociaux en Espagne qu’en France. Elles sont prioritaires au sein des processus d’accès aux logements sociaux et aux maisons de retraite.
Dans le cadre professionnel, elles profitent d’un aménagement de leur emploi du temps, ont droit à la mobilité géographique et peuvent demander une suspension temporaire du poste avec le maintien du contrat de travai
En Espagne, il existe enfin des tribunaux spécialisés qui traitent des affaires de violences conjugales tant sur le versant pénal que civil. Créés par la loi de 2004, il en existe 33 dans le pays : “Le juge des violences doit prononcer les mesures de tutelle, de garde, de visite. Nous avons les mêmes compétences qu’un juge aux affaires familiales. Il y a une obligation de prononcement. Si le juge ne prend pas de mesures, il devra dire pourquoi”, témoigne Margarita Perez Salazar, juge spécialisée dans les violences conjugales.
La France s’est tout de même déjà inspirée de son voisin à travers l’ordonnance de protection (qui permet au juge aux affaires familiales d’assurer dans l’urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.), le téléphone grave danger (permettant à une victime de violences conjugales de contacter directement une plateforme spécialisée en cas de danger) et le bracelet anti-rapprochement (dispositif de surveillance électronique qui permet de géolocaliser une personne à protéger et un auteur réel ou présumé de violences conjugales).
Si une révolution des politiques en matière de lutte contre les violences faites aux femmes n’est néanmoins pas encore à l’ordre du jour en France, rien n’empêche la société d’enclencher un changement de regard. Sans se muer en juge, il s’agit peut-être de s’appliquer à faire davantage preuve d’empathie car la croire n’est pas le condamner. On ne peut pas continuer à dénoncer les violences faites aux femmes sans dénoncer la masculinité.
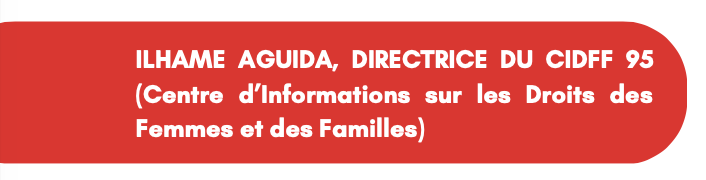
Combien de temps en moyenne une femme victime de violences met-elle pour faire valoir ses droits ?
Chaque cas est unique, mais la victime se retrouve le plus souvent face à des procédures longues et diverses en raison de leur superposition. Dans le cadre des violences faites aux femmes, les procédures sont en effet beaucoup plus nombreuses que dans d’autres affaires pénales car elles s’inscrivent au sein de plusieurs champs de judiciarisation (pénal et civil) ; impliquant généralement un divorce, des mesures de protection, des modalités d’exercice de l’autorité parentale, etc. La victime se retrouve alors suspendue à de multiples décisions aux mains de différents interlocuteurs (juge pénal, juge aux affaires familiales, juge d’instruction, juge des enfants). Il s’agit donc d’un temps généralement long et usant.
Parmi les mesures nouvelles pour lutter contre les violences faites aux femmes est évoquée la création d’une juridiction spécialisée, quels avantages et inconvénients selon vous ?
Selon moi, le dispositif législatif français est déjà assez complet pour répondre aux prérogatives qui sont les siennes concernant les violences faites aux femmes. Les moyens de la Justice doivent néanmoins être profondément renforcés pour qu’elle remplisse convenablement sa mission. Il s’agirait également d’initier un grand plan de formation auprès des magistrat(e)s afin qu’iels comprennent davantage le psychotrauma qui accompagne les victimes de violences.
Dans ce contexte encore très pesant, l’idée de mobiliser des magistrat(e)s qui seraient dédié(e)s aux violences faites aux femmes serait donc la bienvenue pour désengorger les tribunaux et accélérer les processus. Mais comment une femme isolée pourrait-elle espérer avoir recourt à une juridiction spécialisée quand celle-ci ne serait disponible que dans certains tribunaux ? Qu’en est-il également des crimes jugés en cours d’assises?
Dans les cas de faits de violences faites aux femmes, quels intérêts pourrait présenter la mise en place de la présomption de culpabilité ?
En matière de violences conjugales, il est très difficile d’apporter des preuves, un doute subsiste toujours sur la véracité des faits. Or, le doute pèse toujours sur les femmes. C’est pourquoi cette possibilité pourrait présenter plusieurs intérêts. Cependant, encore une fois, je crois beaucoup à la formation de toutes et tous, auprès des professionnel(le)s et du grand public. La présomption de culpabilité prend d’ailleurs de plus en plus de place dans l’opinion publique et participe à sensibiliser le plus grand nombre. C’est pourquoi il ne me semble pas forcément nécessaire que cela s’inscrive formellement dans le droit français qui s’applique déjà à rendre compte de la vérité. Nos représentations, plus que les textes de loi, doivent évoluer.
* Enquête Leenan & Murray (2006) : 2,1% ; Lisak et al. (2010) : 5,9% ; National Sexual Resources Center (2012) : 2 à 8%
** arretonslesviolences.gouv.fr
*** Ministère de l’Intérieur, Interstats Analyse n. 32 **** Association Face à l’inceste